/
06
/
23
L’Alaska des forêts sauvages et l’Alaska des peuples autochtones Jamey Bradbury et Marie-Hélène Fraïssé
À Pau, à la médiathèque André Labarère, ce 1er juin 2023, le public (une quarantaine de personnes), voyageait depuis l’Alaska de Jamey Bradbury et Marie-Hélène Fraïssé jusqu’à l’Islande de Stéphane Dugast.
La rencontre entre la romancière américaine et l’écrivaine et journaliste spécialiste des peuples autochtones, ouvrait le festival sur deux visions de l’Alaska : l’Alaska des forêts sauvages, lieu d’un roman d’horreur qui est beaucoup plus qu’un roman d’horreur et révèle un personnage féminin dont la « dichotomie intérieure » (selon les mots de Jamey Bradbury quelques jours plus tard à Laruns) se reflète dans sa double relation aux animaux et dans sa propre sauvagerie intérieure. De la forêt, elle tire sa subsistance, dans la forêt où elle court pour se ressourcer, elle retrouve sa force intérieure, mais dans la forêt également, elle va rencontrer l’inconnu et le danger.
Jamey Bradbury
*La page blanche comme « espace de nature sauvage »**
Jamey Bradbury explique son écriture :
« Une page blanche est un espace de nature sauvage. C’est une toundra sans trait marquant, sans aucun repère pour l’interrompre. Il n’y a aucune borne kilométrique, aucune route, aucun panneau indiquant que vous allez dans la bonne direction. Pas étonnant qu’il soit si facile de se perdre ».
La genèse de son roman, c’est une image et des questions.
« Quand j’ai commencé à écrire Sauvage, je n’avais aucune boussole. Aucune carte, aucun contour, aucune direction. Tout ce que j’avais, c’était une image : une cabane au milieu d’une clairière dans une forêt enneigée. Ses fenêtres étaient éclairées dans l’hiver d’Alaska. Je savais qu’il y avait deux personnes à l’intérieur de la cabane, qui en attendaient une troisième. Qui était la troisième ? Que lui était-il arrivé ? Pourquoi n’était-elle pas encore rentrée ? »
« Sauvage en dedans »
C’est un roman intitulé Some of Your Blood, de Theodore Sturgeon, sorti en 1961, qui lui a donné une idée. Et si ce « vampire non surnaturel qui consomme le sang à la fois des animaux et des gens », et qui est un « jeune homme qui a grandi dans le sud rural de l’Amérique », si ce personnage « était une femme au lieu d’être un homme ? » Jamey Bradbury avait déjà décidé qu’elle situerait The Wild Inside (Sauvage), son premier roman, dans l’Alaska rurale. Elle soulignera deux jours plus tard le sens du titre américain original, différent de sa traduction française. The Wild Inside, c’est le sauvage à l’intérieur du personnage. Elle ne se sent bien que dans la nature sauvage et il y a en elle également cette nature sauvage qui va la conduire à des actes paradoxaux et à une violence extrême et pourtant non voulue, où c’est en voulant protéger qu’elle tue.

Tracy, le personnage principal, une adolescente qui vit dans une maison isolée avec son père et son frère, après avoir perdu sa mère, interroge le lecteur sur le rapport au sauvage : sauvage de la nature y compris de la nature humaine. Le personnage de la mère a un rôle très fort même si elle est absente de la vie réelle : présence fantomatique surnaturelle qui accompagne Tracy ou présence remémorée dans des flash-backs, cette mère absente et si présente explique la souffrance intérieure de Tracy tout en lui apportant une aide, et elle explique ce sauvage en elle : sauvage atavique ou sauvage d’une souffrance infinie ? Tracy aurait aussi, comme le personnage masculin de Some of Your Blood, « une compréhension très limitée du monde au-delà de la maison isolée de sa famille. Rapidement, elle s’est mise à chasser, à explorer les bois, et est devenue une musher qui était très proche de ses chiens », nous explique la romancière. En connexion parfaite avec la nature sauvage de la forêt et avec ses chiens, elle est souvent perdue dans sa relation au monde humain. Sa manière d’aimer, à la fois protectrice et sauvage, la perturbe autant qu’elle nous perturbe. C’est en courant dans la forêt, ou en s’occupant de ses chiens qu’elle se retrouve. C’est en buvant le sang des animaux qu’elle piège qu’elle retrouve sa force. Mélange d’inspiration vampirique d’un roman d’horreur et d’une réalité inscrite dans la terre d’Amérique qui nous rappelle les peuples autochtones des Grandes Plaines, qui trouvaient leur force en mangeant le foie des bisons juste tués. Horreur du geste ou connexion avec l’animal au-delà de sa vie ?
L’Alaska comme inspiration et matière vivante
En racontant la genèse de son roman, Jamey Bradbury nous fait entrer dans cet espace mystérieux qui réunit le monde intérieur de l’écrivaine et la voix imaginée du personnage qu’elle est en train de créer. Le langage n’est plus celui de la romancière, mais une langue qui fait entendre la voix de Tracy, son personnage.
« La langue qu’elle utilise pour décrire son monde vient de la nature. En écrivant comme Tracy, les métaphores et la variété de vocabulaire sur lesquels j’avais l’habitude de m’appuyer en tant qu’écrivaine ne m’étaient plus accessibles. Je devais développer de nouvelles manières de raconter une histoire et d’écrire des descriptions basées sur la voix de Tracy ».
Son écriture devient un voyage et elle se déplace dans son histoire : « Une fois que j’ai pu entendre sa voix et une fois que j’ai eu le cadre de la manière dont elle interagissait avec le monde, j’ai fini par trouver un véhicule qui allait me conduire à travers l’histoire ».
Elle se place des limites, « de la narration, de la voix, de la perspective » : « Ce n’est que lorsque j’ai eu trouvé une manière de limiter ma propre écriture que j’ai trouvé l’histoire que je voulais raconter et la manière dont je voulais la raconter ». Elle voit Sauvage « comme un roman d’horreur surnaturel » parce qu’elle est « attirée par ce genre de fiction à cause des restrictions qui l’accompagnent ». Il n’y avait aucun doute dans son esprit que son premier roman se situerait en Alaska. Mais ce à quoi elle ne s’attendait pas, « c’est que l’Alaska se révélerait être le lieu parfait pour situer un roman d’horreur — ou, en fait, un roman de quelque genre que ce soit ». L’Alaska fournit tous les obstacles indispensables pour créer le suspens et inventer l’intrigue.
« L’un des moyens les plus faciles pour créer le suspens ou inventer l’intrigue, c’est de rendre la vie compliquée pour vos personnages. Mettre des obstacles sur le chemin d’un personnage le force à agir et l’incite à faire des choix qui le feront avancer jusqu’à la scène suivante ou le retarderont ou lui feront rencontrer un nouvel ensemble d’obstacles […]. Les écrivains de fiction d’horreur comprennent comment des climats froids et des paysages éloignés fournissent des obstacles naturels dans une intrigue — c’est-à-dire des obstacles rendus possibles grâce à la nature ».
Il y a dans ce livre une « tension centrale [qui] est : est-ce que Tracy va rester à la maison pour protéger sa famille, ou va-t-elle disparaître dans la nature sauvage à laquelle elle sent qu’elle appartient ? » Pour écrire des scènes précises, elle s’appuie « sur ce que l’Alaska, en tant que décor [lui] offrait ».
Les paysages d’Alaska lui donnent l’inspiration et la matière, naturelle, vivante, de son roman.
« L’Alaska offre plus que des obstacles simples. Quand vous pensez à l’Alaska, peut-être pensez-vous à ce genre de froid et d’obscurité qui rend le familier soudain étrange. Soudain non familier. Soudain étranger [la romancière utilise ‘alien’ en anglais, et donc aussi étranger au normal, surnaturel]. Le froid intense transforme tout — les arbres, l’eau, notre propre respiration ». Et puis il y a l’obscurité qui « change tout ». « Elle nous aveugle jusqu’à ce que nous nous y habituions — et jusqu’à ce moment, nous nous demandons ce qui pourrait bien nous attendre dans le noir d’encre d’une nuit sans lune. Elle transforme les objets ordinaires en quelque chose de menaçant […]. L’obscurité offre aussi une toile pour quelque chose de magique et saisissant comme les aurores boréales ».
La nature d’Alaska nous apprend à voir notre environnement autrement :
« Finalement, l’Alaska offre un décor parfait pour des histoires d’horreur — et d’autres genres d’histoires — parce que c’est un paysage qui nous force à regarder l’œuvre de diverses façons nouvelles. Ce qui, en fait, est le travail de tous les genres de fiction : fournir un nouveau cadre au monde familier. Nous mettre au défi de voir notre environnement d’une manière nouvelle et inattendue ».
Jamey Bradbury, Sauvage [2019], Editions Gallmeister, 2020.

Marie-Hélène Fraïssé
« Un voyage de résilience »
C’est aussi en Alaska que nous conduit Marie-Hélène Fraïssé, mais dans une démarche différente. Jamey Bradbury vit en Alaska et voit la nature de l’Alaska de l’intérieur. Elle fait de l’Alaska le lieu d’une fiction. Marie-Hélène Fraïssé y arrive lors d’un voyage de résilience, après un deuil, et écrit un récit de voyage où se font face la réalité des lieux et des êtres rencontrés et la réalité de sa perception. Elle a perdu l’homme de sa vie, et elle part à la recherche d’elle-même. On devient une personne nouvelle après la perte d’une personne aimée. Le vide nouveau qui vous habite va peu à peu se remplir. « Ce voyage, je l’ai conçu comme partie prenante d’une entreprise de détachement, d’effacement, de déprise. Larguer le passé, les ombres, les absents trop absents, les présents difficiles vivre… » (p. 21-22). Le voyage, la nature, les rencontres avec les peuples autochtones vont être cet élément guérisseur qui va la conduire vers elle-même. Dans Alaska, l’ultime frontière. En terre amérindienne, de Vancouver à Anchorage, elle nous invite à ce voyage de découverte, à la fois extérieure et intérieure.
Nous voyageons en Alaska avec Marie-Hélène Fraïssé dans le soir de Pau. Elle avait déjà rencontré l’Alaska dans sa vie de grand reporter, mais ce voyage-là est d’un autre ordre, voyage intérieur et quête. Et il permet la rencontre avec les peuples de la côte Nord-Ouest. L’Alaska, elle l’avait « entrevue une première fois, il y a des lustres, dans sa splendeur farouche, depuis une petit monomoteur biplace Cessna équipé de skis ». Elle « survolait, seule passagère, le parc national canadien de Kluane » (Alaska, l’ultime frontière, p. 12). Elle voit d’abord l’Alaska du ciel, d’un avion, contact des yeux seulement. Force de la première rencontre : « Ma première rencontre avec l’Alaska. Le premier déclic. Love at first sight » (p. 13). Ce nouveau voyage, c‘est « pour de bon. ‘Pour de vrai’, comme disent les enfants » (p. 13).
L’écriture d’une identité
Marie-Hélène Fraïssé, dans ce voyage conçu au départ comme une « entreprise de détachement, d’effacement », va écrire une nouvelle page sur sa propre vie, à travers des rencontres. Lorsqu’elle parle des hommes et des femmes qu’elle a rencontrés, elle fait surgir devant nous ces peuples autochtones qui, souvent, dans d’autres lieux, ont été effacés d’une autre manière. Là, en Alaska, sur la côte Nord-Ouest, dit-elle, il n’y a pas eu les déportations, l’acculturation qu’il y a eue chez les peuples des Etats-Unis. Ils continuent à être ce qu’ils ont toujours été. Les noms de lieux ont retrouvé leur origine. Elle nous parle de Haïda Gwai, « la Terre des Hommes ». Les explorateurs l’ont nommée un moment « L’île de la reine Charlotte », effaçant le nom autochtone pour le remplacer par l’histoire européenne de la colonisation. Mais les Haïda lui ont redonné son nom d’origine, Haïda Gwai. La toponymie comme écriture d’une identité (Romain Bourbon nous le montrera pour les Pyrénées quelques jours plus tard). C’est en 2009 que l’archipel retrouve son nom. Marie-Hélène Fraïssé l’explique dans son livre : « en 2009, l’archipel finit par retrouver son nom ancestral, démontrant au reste du monde que les Haïdas se considéraient toujours chez eux dans ce dédale de quelque cent cinquante îles et îlots d’un beauté stupéfiante, couverts de denses forêts moussues, cerclés d’eaux turquoise où croisent par milliers saumons, flétans et orques, ainsi que lares rare baleine grise… » (p. 124). Le retour de l’identité dans sa description va avec l’observation de la nature sauvage. Monde humain et monde non humain sont inséparables dans le nom retrouvé.
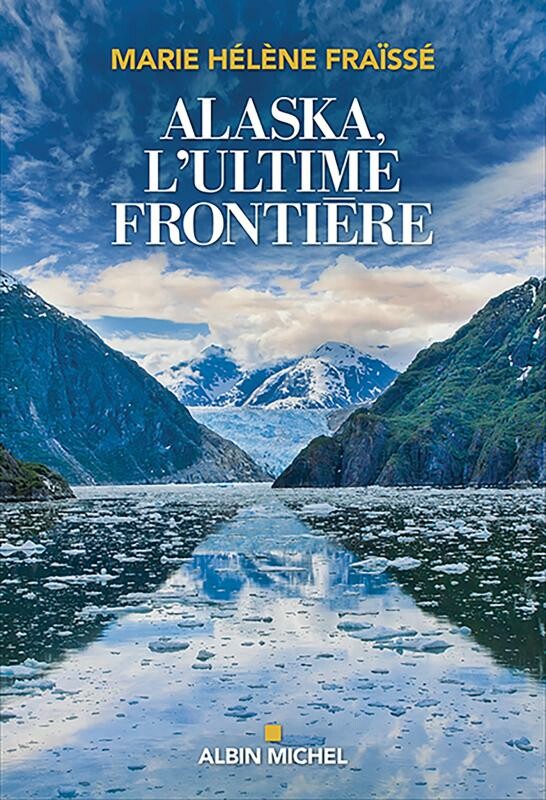
« Le Chant de l’Oiseau-mouche »**
En écoutant Marie-Hélène Fraïssé parler avec passion de son voyage et de ses rencontres en Alaska, on voit l’Alaska, on retrouve dans ses mots la passion qui l’anime et aussi la beauté du langage de son livre où les paysages d’Alaska, où la vie, des hommes et des espaces, des animaux et de la langue, sont décrits avec une force poétique intense. On sent toute la force de son livre dans sa manière de nous parler de ce voyage. Rencontres avec les « gens de parole » (p. 162), celles et ceux qui « consacrent le meilleur de leur énergie militante » à « la renaissance de leur langue », rencontres avec la romancière Eden Robinson, avec Martine, la troisième épouse de Bill Reid, dont le corbeau créateur vous accueille dans divers endroits du Canada, rencontre avec Nika, la petite-fille du sculpteur, qui chante « le Chant de l’Oiseau-mouche ». « C’est un chant d’amour Haïda, que nous avons offert aux Nootkas en signe d’union » (une note précise que « les Nootkas, ou Nuu-chah-nulth, habitent l’île de Vancouver, au sud de l’archipel occupé par les Haïdas ») (p. 164). Rencontres qui parlent de bienveillance, d’accueil, d’union. « Chez nous, on ne dit pas good bye, mais I’ll see you again** », dit Nika (p. 164).
Elle écrit en conclusion de son livre :
« Voyage rime avec mirage. Il y a ceux qui vous appellent, qu’on garde en réserve pour l’avenir, ceux vers lesquels on fonce tête baissée, et qui se dissolvent chemin faisant. Ceux enfin qui conduisent à des lointains plus riches encore que ne le laissait présager leur apparence première. On n’en aura le cœur net qu’après le retour, longtemps après. Et il se peut, tout compte fait, une fois revenu au pays, la boucle bouclée, le bagage posé, qu’on ait appris deux ou trois choses sur soi-même et sur le monde.
Car le terme de toutes nos quêtes
Sera d’arriver là d’où nous étions partis
Et pour la première fois de reconnaître ce lieu.
T.S. Eliot, « Little Gidding ».
(Alaska, l’ultime frontière, p. 334).
Marie-Hélène Fraïssé, Alaska, l’ultime frontière. En terre amérindienne, de Vancouver à Anchorage, Albin Michel, 2023).
- C’est une Alaska multiple, obscure et lumineuse, naturelle et spirituelle, mystérieuse et transparente, que nous font découvrir ces deux voix de femmes, si différentes et si proches dans leur amour profond de l’Alaska. Nous étions tous et toutes en Alaska ce soir-là, dans un voyage d’exploration à la fois à travers l’écriture et à travers la nature. Dialogue de femmes qui nous ouvre les yeux sur un monde lointain et intérieur en même temps. Voix de femmes qui, tout en nous montrant le monde sauvage de l’Alaska et les blessures de l’Histoire ou intérieures, nous apprennent à lire l’Autre et à nous lire nous-mêmes en écoutant la nature qu’elles écrivent du plus profond de leur être.
« Chez nous, on ne dit pas good bye, mais I’ll see you again »…
(Marie-Hélène Fraïssé, Alaska, l’ultime frontière. En terre amérindienne, de Vancouver à Anchorage, Albin Michel, 2023).
Compte rendu rédigé par Françoise Besson